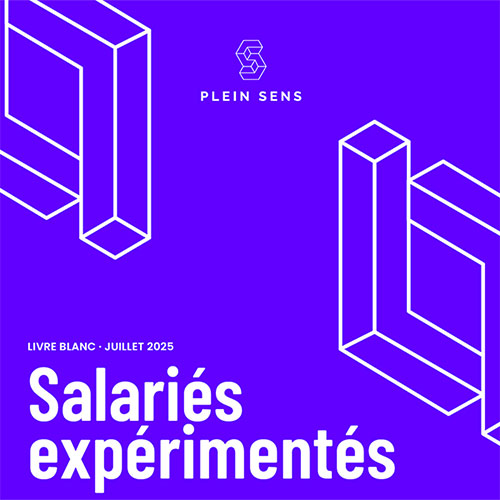En entreprise, tout ne commence pas par un conflit ouvert. Trop souvent, les tensions s’installent en silence : remarques déplacées, frustrations, décisions mal vécues… Ce sont des conflictualités, ces tensions qui traversent la vie professionnelle avant de devenir des conflits. Invisibles mais bien réelles, elles sont aujourd’hui l’un des angles morts majeurs de la gestion managériale. Distinguer les conflits des conflictualités est alors un prérequis essentiel pour apaiser les relations au travail.
Une réalité largement sous-estimée
Une étude de la DARES (février 2024) révèle que 47% des entreprises sont confrontées à des conflits individuels. Parmi elles, 71% observent des tensions entre salariés, et 30% entre représentants du personnel et direction. Ces tensions ne sont pas sans conséquences : arrêts maladie, accidents, baisse de qualité, désengagement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les signaux sont là, mais nous ne savons pas les voir.
Les conflictualités ne sont ni ponctuelles, ni anodines. Elles relèvent de processus longs, imbriqués dans la dynamique collective et les événements quotidiens de l’entreprise. Ce sont des ressentis d’injustice, des peurs, des désaccords enfouis qui, faute d’être nommés et accompagnés, fragilisent les collectifs et mènent à la rupture.
Le malaise silencieux des collectifs
La gestion managériale actuelle est souvent démunie face à ces tensions. Là où les conflits étaient autrefois visibles et collectifs — grèves, mobilisations, négociations — les tensions d’aujourd’hui sont diffuses, individualisées, et parfois ignorées. Il n’est pas rare de voir des équipes s’organiser entre elles pour éviter une personne toxique, tandis que les arrêts maladie s’accumulent. Le conflit n’éclate pas, mais la souffrance s’enracine.
Le problème ? Les managers ne sont pas toujours formés à écouter, accueillir ou encadrer ces signes avant-coureurs. Ils les minimisent, ou les considèrent comme passagers. Or, ne pas traiter une conflictualité, c’est laisser se dégrader la relation au travail.
Vers un nouveau rapport au travail
Ce phénomène traduit une mutation plus profonde : l’entreprise n’est plus un espace fondé sur des normes implicites partagées. Les processus d’individuation se sont accélérés, rendant le collectif plus fragile. Aujourd’hui, certains comportements autrefois tolérés sont désormais sanctionnés — et c’est une avancée. Mais le décalage entre ceux qui changent, ceux qui résistent, et ceux qui ne comprennent pas ce qui leur est reproché alimente les tensions.
Dans ce contexte, la responsabilité juridique de l’employeur s’est renforcée. La santé mentale des salariés est protégée par la loi, et les dispositifs de signalement — notamment grâce à la loi Sapin II — permettent de mieux protéger les lanceurs d’alerte. Pourtant, les procédures prud’homales baissent, laissant place à des ruptures conventionnelles silencieuses, qui ne traitent pas les causes profondes.
Transformer les tensions en leviers d’action
Bonne nouvelle : il est possible d’agir. Des méthodes existent pour identifier, nommer et encadrer les conflictualités. Il ne s’agit pas de les faire disparaître, mais de leur offrir un espace d’expression, un cadre et une temporalité. Car le désaccord est normal, et lorsqu’il est reconnu et travaillé, il devient un moteur de transformation plutôt qu’un facteur de rupture.
Aujourd’hui, les organisations qui réussissent sont celles qui apprennent à écouter ce qui dérange, à anticiper ce qui pourrait exploser, et à bâtir une culture du dialogue sincère. Car si le conflit coûte cher, la conflictualité, elle, peut éclairer et réparer. À condition de la considérer comme une donnée stratégique — et non comme une faiblesse.
Éric Molière, docteur en sociologie, associé de Plein Sens et co-créateur de l’École des Conflictualités